C'est en 1976, à la fin d'un concert des 101'ers que Mick Jones et Paul Simonon (deux anciens étudiants des beaux-arts et respectivement guitariste et bassiste dans le groupe London SS) craquent sur le chanteur, un certain Joe Strummer, et lui proposent de les suivre pour fonder The Clash. Rejoint par le batteur Terry Chimes, lui-même remplacé très vite par Topper Headon, le groupe se taille en quelques mois une réputation incendiaire dans le milieu punk qui commence à agiter la capitale londonienne. En 1977, un premier single White Riot se classera dans les charts anglais avant la sortie chez CBS du premier album du groupe, tout simplement intitulé The Clash et enregistré seulement en trois week-ends ! La production ultra-dépouillée de ce premier album, les textes politiques et idéalistes de Joe Strummer et l'incroyable présence scénique du groupe, vont imposer The Clash comme LE groupe punk, les Sex Pistols continuant de s'enfoncer dans le nihilisme avant de se saborder en 1978.
Mais The Clash est surtout le premier groupe rock à intégrer le reggae, musique alors très marginale, avec la fameuse reprise de Junior Murvin, Police And Thieves et White Man In Hammersmith Palais qui sera élu single de l'année dans de nombreuses revues. Le groupe part alors sur le White Riot Tour avec The Jam et The Buzzcocks pour finir par une date au London Rainbow Theatre où le public déchaîné arrachera tous les fauteuils de la salle. L'image de rebelles et de hors la loi de The Clash ira croissant suite à quelques démêlés avec la justice pour vandalisme et tir aux pigeons en plein Londres, incident qui donnera lieu à la chanson Guns On The Roof.
 Changement de son en 1979 avec Give 'Em Enough Rope, leur deuxième album produit clairement pour conquérir le marché américain, sous la pression de leur maison de disques, par Sandy Pearlman (producteur du Blue Oyster Cult), qui fera crier à la trahison heavy metal certains fans du groupe. S'ensuit leur première tournée américaine et un EP The Cost Of Living où figurera la fameuse reprise de Bobby Fuller Four, I Fought The Law. Le disque finira à la deuxième place des charts anglais mais le groupe est déjà parti sur d'autres projets : une nouvelle tournée américaine avec Bo Diddley, Screamin' Jay Hawkins et The Cramps, prouvant la fascination qu'exerce le rock'n'roll américain et ses légendes sur nos sujets britanniques et un film Rude Boy qui suit la vie de The Clash en tournée à travers les yeux d'un fan paumé et qui sortira en salles au printemps 1980.
Changement de son en 1979 avec Give 'Em Enough Rope, leur deuxième album produit clairement pour conquérir le marché américain, sous la pression de leur maison de disques, par Sandy Pearlman (producteur du Blue Oyster Cult), qui fera crier à la trahison heavy metal certains fans du groupe. S'ensuit leur première tournée américaine et un EP The Cost Of Living où figurera la fameuse reprise de Bobby Fuller Four, I Fought The Law. Le disque finira à la deuxième place des charts anglais mais le groupe est déjà parti sur d'autres projets : une nouvelle tournée américaine avec Bo Diddley, Screamin' Jay Hawkins et The Cramps, prouvant la fascination qu'exerce le rock'n'roll américain et ses légendes sur nos sujets britanniques et un film Rude Boy qui suit la vie de The Clash en tournée à travers les yeux d'un fan paumé et qui sortira en salles au printemps 1980.
Pour leur troisième album, un double, le groupe n'entend plus se laisser dicter de conditions par qui que ce soit et, épaulé par le producteur Guy Stevens, entreprend ce qui sera le gros œuvre de sa carrière, le mythique London Calling. Dans ce qui restera comme l'un des disques les plus importants de l'histoire du rock, reggae, punk-rock, New-Orleans, rockabilly et ska se côtoient dans le plus grand bonheur et mettent le feu à la popularité de The Clash.
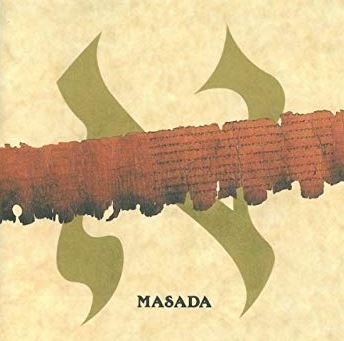

 Changement de son en 1979 avec Give 'Em Enough Rope, leur deuxième album produit clairement pour conquérir le marché américain, sous la pression de leur maison de disques, par Sandy Pearlman (producteur du Blue Oyster Cult), qui fera crier à la trahison heavy metal certains fans du groupe. S'ensuit leur première tournée américaine et un EP The Cost Of Living où figurera la fameuse reprise de Bobby Fuller Four, I Fought The Law. Le disque finira à la deuxième place des charts anglais mais le groupe est déjà parti sur d'autres projets : une nouvelle tournée américaine avec Bo Diddley, Screamin' Jay Hawkins et The Cramps, prouvant la fascination qu'exerce le rock'n'roll américain et ses légendes sur nos sujets britanniques et un film Rude Boy qui suit la vie de The Clash en tournée à travers les yeux d'un fan paumé et qui sortira en salles au printemps 1980.
Changement de son en 1979 avec Give 'Em Enough Rope, leur deuxième album produit clairement pour conquérir le marché américain, sous la pression de leur maison de disques, par Sandy Pearlman (producteur du Blue Oyster Cult), qui fera crier à la trahison heavy metal certains fans du groupe. S'ensuit leur première tournée américaine et un EP The Cost Of Living où figurera la fameuse reprise de Bobby Fuller Four, I Fought The Law. Le disque finira à la deuxième place des charts anglais mais le groupe est déjà parti sur d'autres projets : une nouvelle tournée américaine avec Bo Diddley, Screamin' Jay Hawkins et The Cramps, prouvant la fascination qu'exerce le rock'n'roll américain et ses légendes sur nos sujets britanniques et un film Rude Boy qui suit la vie de The Clash en tournée à travers les yeux d'un fan paumé et qui sortira en salles au printemps 1980.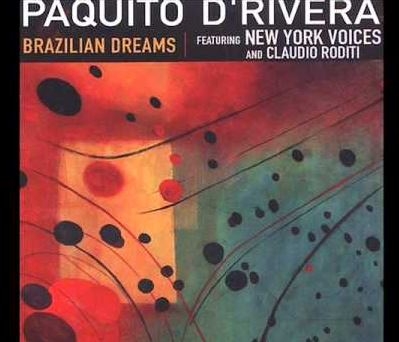 «
«